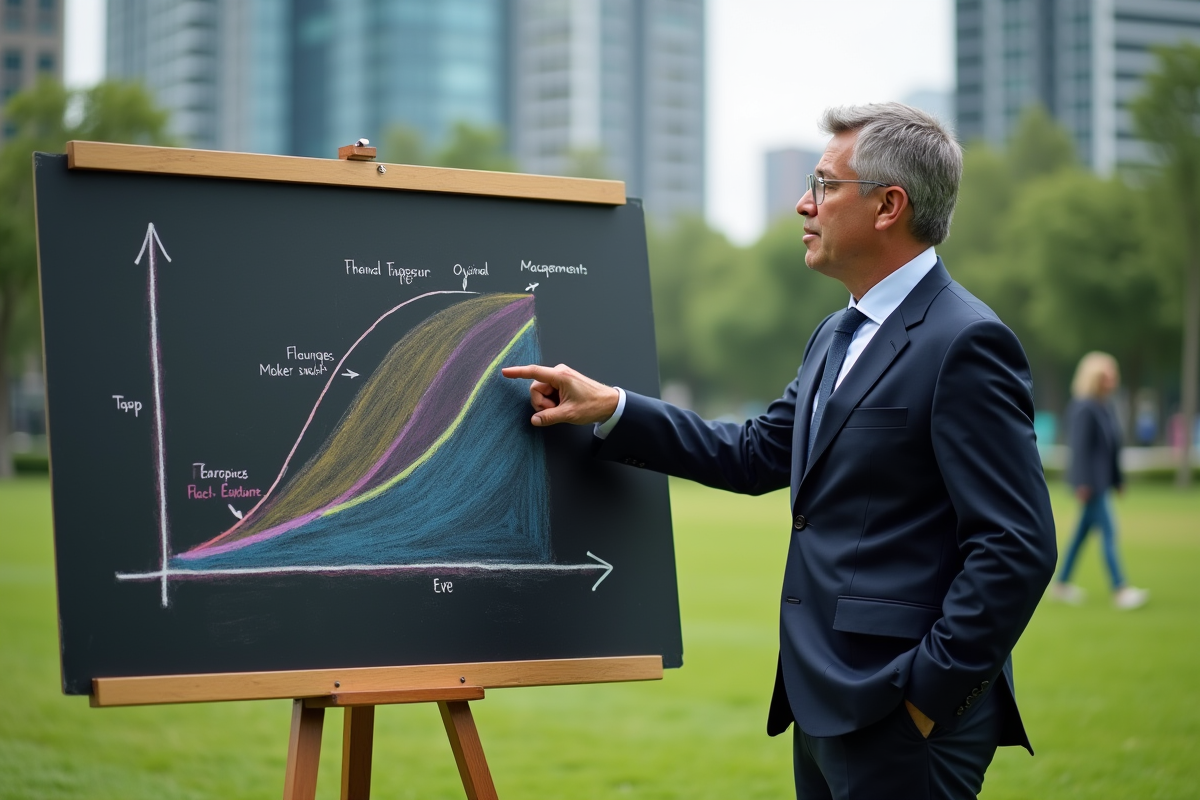Le partage de la croissance mondiale depuis les années 1980 ne suit aucune répartition linéaire. Tandis qu’une large partie de la population a vu son niveau de vie progresser, certains groupes ont stagné, voire reculé, malgré une hausse globale des richesses.
Ce phénomène met en lumière des dynamiques économiques internationales qui interrogent aussi bien les choix de politiques publiques que les mécanismes de redistribution. Les écarts observés révèlent des effets inattendus de la mondialisation et posent des questions structurantes sur la manière de corriger ces déséquilibres.
La courbe de l’éléphant : comprendre un symbole des inégalités mondiales
Impossible d’aborder le thème des inégalités globales sans évoquer la fameuse courbe de l’éléphant. Proposée par Branko Milanovic et Christoph Lakner pour la Banque mondiale, ce graphique a fait date dans l’analyse de l’évolution des revenus mondiaux. Sa forme singulière, une montée, une chute, puis un redressement abrupt, en dit long : la redistribution des bénéfices de la mondialisation s’est faite de façon très inégale.
Sur la période 1988-2008, la croissance mondiale a fortement enrichi la classe moyenne de certains pays émergents, comme la Chine ou l’Inde, permettant à d’immenses populations d’améliorer leurs conditions de vie. Ce succès ne doit pas masquer une autre réalité : au centre de la courbe, un “ventre mou” signale la stagnation, voire l’érosion, des revenus pour la classe moyenne des pays développés. Durant ce temps, l’extrémité droite de la “trompe” illustre la croissance fulgurante des revenus des plus riches à l’échelle internationale.
En une image, la courbe de l’éléphant contraint à regarder en face une redistribution du progrès qui bouscule les hiérarchies habituelles : l’enrichissement ne s’est pas fait partout de la même façon, ni au même rythme, et certains ont vu la couleur des profits bien plus que d’autres.
Pourquoi la mondialisation n’a-t-elle pas profité à tous ? Le choc des trajectoires
Les bouleversements impulsés par la libéralisation des échanges et l’intensification du commerce mondial ont redistribué les cartes des revenus avec une ampleur inédite. Les chiffres sont éloquents : la croissance fulgurante de certains pays émergents a facilité un véritable bond en avant pour des millions de foyers, notamment en Chine et en Inde. Pour toute une partie de la population mondiale, la mondialisation a permis un rattrapage longtemps jugé hors de portée.
Pourtant, cette dynamique a eu son prix. Les classes moyennes d’Europe occidentale et des États-Unis ont, pour beaucoup, connu l’essoufflement : désindustrialisation, délocalisations et précarisation de l’emploi se sont conjuguées avec une croissance atone. L’accélération des inégalités internes, accélérée par la crise financière de 2008, a renforcé le sentiment de déclassement pour une grande partie de la population.
Parallèlement, dans plusieurs régions d’Afrique subsaharienne ou d’Amérique latine, le décollage promis n’a pas toujours trouvé sa réalité. Si l’écart entre les grandes zones économiques tend à se réduire, la fracture à l’intérieur des pays, qu’ils soient riches ou émergents, ne cesse de s’amplifier. En clair, la mondialisation n’a pas effacé les écarts ; elle en a parfois forgé de nouveaux.
Démondialisation, tensions sociales et impacts économiques : quels enjeux pour demain ?
L’accumulation des richesses par une poignée d’ultra-riches, face à la stagnation de la majorité, alimente aujourd’hui des tensions de plus en plus vives. La concentration du patrimoine et des revenus atteint des niveaux rarement vus depuis cent ans. L’indice de Gini, qui mesure les écarts de revenus, reste à des valeurs élevées malgré le décollage de certains émergents. Les dispositifs traditionnels de redistribution, socle des modèles sociaux, vacillent sous la pression de la concurrence fiscale et du développement de mécanismes d’évasion fiscale.
Cette situation redonne des couleurs aux velléités de démondialisation. Ici et là, la tentation du repli, de la relocalisation, des barrières tarifaires ressurgit dans les débats publics. Néanmoins, cette trajectoire comporte ses propres risques : elle peut amplifier les tensions sociales, ralentir la croissance et fragmenter davantage l’économie mondiale. Parmi les plus fortunés, l’influence grandit, et pour une majorité silencieuse, le sentiment d’être laissée de côté devient brutalement palpable.
Ces débats excèdent désormais la seule sphère économique. Ils touchent à la justice sociale, à la fiscalité et aux enjeux environnementaux. Les pistes de réforme sur la taxation des hauts revenus, le contrôle du patrimoine ou la lutte contre l’évasion fiscale ne relèvent plus du détail technique : ils posent, en creux, la question du modèle de société souhaité dans une période de bouleversements profonds.
Quels leviers pour endiguer durablement les inégalités ?
À mesure que la courbe de l’éléphant s’impose dans le débat public, la question revient sans cesse : comment agir sur ces inégalités en plein essor ? Des figures du débat intellectuel, comme Amartya Sen ou John Rawls, invitent à repenser la notion d’égalité des chances et à dépasser la seule logique de distribution financière. De grandes organisations internationales y voient aussi un chantier prioritaire pour l’avenir.
On peut identifier plusieurs axes pour tenter de répondre à ce défi majeur :
- Renforcer une fiscalité réellement progressive : prélever davantage sur les revenus et le patrimoine des plus fortunés pour alimenter des politiques sociales ciblées, en particulier dans les pays en développement.
- Investir dans les services publics : garantir à tous l’accès à l’éducation, à la santé, à la protection sociale reste l’un des outils les plus efficaces contre la reproduction des inégalités. Des penseurs comme Pierre Bourdieu ou Michael Walzer en ont montré l’impact décisif pour la cohésion sociale.
- Mener une véritable lutte contre l’évasion fiscale : sans contrôle accru des circuits financiers opaques et des avoirs déplacés hors d’atteinte, toute volonté de redistribution reste un vœu pieux. La transparence et la coopération internationale sont plus que jamais sur la table.
Agir contre les inégalités suppose aussi de mieux répartir les ressources à l’échelle internationale : cela passe par un soutien concret aux pays en développement, un accès généralisé aux innovations médicales ou encore des investissements destinés à favoriser le développement collectif. La question de la justice fiscale se noue avec celle de la transition écologique, désormais, progrès social et urgence environnementale avancent de pair, sous l’impulsion de la société civile et des chercheurs du monde entier.
La courbe de l’éléphant, en somme, n’est pas qu’un graphique marquant. C’est un révélateur qui insiste, silencieusement mais fermement : si la redistribution reste une affaire de chiffres, elle façonnera surtout le visage des sociétés de demain.